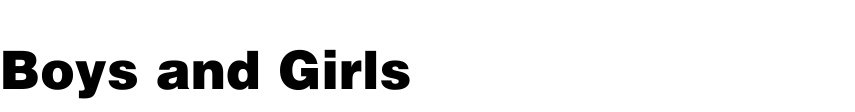AUTEUR: IVO MARTINS
EDITIONS: E-Zine Vector [www.virose.pt] / Website Jazz Portugal [www.jazzportugal.ua.pt] DATES: Juin 2003, Octobre 2003
Un jour, alors que j'accomplissais quelques unes de mes tâches habituelles en rapport avec le jazz, je me suis mis
à réfléchir à un certain nombre de questions anciennes, qui s'étaient imposées à mon esprit pendant mes
expériences musicales et artistiques. Tous les points d'interrogation étaient là, et c'est à partir de ces doutes que
je me suis mis à construire, peu à peu, un discours minimal de rationalité qui m'a aidé à progresser dans ce
territoire si terriblement appauvri de certitudes et que je suis obligé de saisir à travers des discours simplifiés et
dépourvus de contenu.
Je savais déjà que, quand les gens écoutent de la musique, ils sont toujours en train d'appliquer à ce qu'ils
entendent toute leur capacité de comprendre. Je savais déjà que, dans beaucoup d'autres circonstances de notre
vie, nous pensons toujours avec nos propres intérêts, nos intérêts les plus mesquins, bien souvent. J'avais
également compris que ce processus se déroulait naturellement et que l'acte de comprendre y est impliqué. Dans
ce sens, on peut considérer que la recherche d'une certification de normalité est sous-jacente à ce mécanisme de
recherche. La normalité qui provient du fait que nous comparons ce que nous entendons avec les goûts qui sont
exprimés par une majorité dite « normale ». Ce qui nous est donné à entendre se convertit en une simple action
d'attention, qui est avant tout un test personnel appliqué au besoin de vouloir appartenir à un collectif
normalisateur et protecteur, à une synthèse de nombreuses manières d'entendre et dont une évaluation
désintéressée de ce qu'on écoute fait que l'on puisse parler d'un goût collectif et uniformisé . Baudelaire affirmait
que « le goût exclusif du Vrai (noble aptitude, quand elle est appliquée à ses propres fins) opprime le goût du
Beau » (1).
En fait, la vérité se manifeste comme un élément d'analyse fondamental, sauf si elle empêche la captation du
beau. Si les gens s'inquiètent surtout de leur vérité - leur vérité personnelle, et c'est encore plus grave - et ne
soumettent pas leurs aptitudes, plus ou moins éclairées, à la pure acceptation du beau, le mécanisme de sûreté
qui se traduit par le désir de comprendre automatiquement ce qu'ils écoutent laisse de côté les expériences les
plus intéressantes de tout processus ouvert de compréhension. Ce qui est important à ce niveau c'est de savoir ce
que l'on veut vraiment, alors que l'on ignore les limitations que ce genre d'attitude entraîne. Mais quand on
comprendra que, associées à ces raisons défensives, il y en a d'autres qui sont liées à la protection de l'intégrité
personnelle, au maintien du territoire et de l'espace d'influence de chacun, à la valeur de sa capacité d'interaction
dans le groupe, on pourra voir à quel point tous ces intérêts sont éloignés d'une véritable attitude de recherche du
beau. Pour tous ces gens, l'art finit par être une activité sociale, politique et économique de plus, une pure
rhétorique de style.
« Notre vision de la vie moderne tend à se diviser en deux niveaux, le matériel et le spirituel : certains se vouent au
« modernisme », envisagé comme une sorte de pur esprit qui se développe en fonction d'impératifs artistiques et
intellectuels autonomes ; d'autres se placent dans l'orbite de la « modernisation », qui est un complexe de
structures et de procédés matériels - politiques, économiques et sociaux - qu'une fois déclenchés, se développent,
en principe, de manière autonome, sans pratiquement aucune intervention de l'esprit ou de l'âme humaine » (2).
Le problème qui se pose ici, c'est l'insistance sur une accentuation négative concernant la façon dont pourrait
s'effectuer avec succès le passage de la pensée à l'acte, sans qu'aucun d'entre eux ne soit profané, sans qu'aucun
d'entre eux n'agisse sur l'autre pour le détruire. Ils apparaissent tous les deux comme prémonitoires, dans la
mesure où l'on peut parfaitement faire la différence entre « l'homme Faust, celui qui fait l'histoire » et l'autre,
qui reste et qui vit dans le vieux monde. L'écrasante majorité des gens ne vit plus dans des « petits mondes »,
notre actuelle façon de vivre ne peut sans doute que représenter d'une manière métaphorique la nostalgie de nos
mondes perdus. Peut-être que l'art, lui, pourra incarner cette représentation et, justement à cause de cela, celle-ci
sera toujours dépendante d'une atmosphère intérieure de destruction, de perte et de mort. Et peut-être qu'alors
les gens auront également beaucoup de difficultés pour arriver à cohabiter dans de bonnes conditions dans un
contexte si difficile. Dans ce contexte, la sensation d'un collapsus imminent va générer toute sorte de petites
incertitudes et toutes les anxiétés chercheront désespérément à se placer à travers des mécanismes plus actifs où
le poids de la composante idéale sera successivement déchargé par l'utilisation d'une méthode activiste,
militante, volontariste et, donc, « modernisatrice ». Quand ce procédé est adopté par des artistes, par ceux qui,
par principe, devraient savoir cohabiter sur ce terrain sans perdre leur identité éthique, alors, ces artistes
présentent dans leurs gestes le résultat d'une grande pauvreté qui ne va pas plus loin que les petits vices d'un
monde « à la Faust », parce qu'ils passent leur temps à confronter leur misérable petite vie en sursis avec la mort.
Je crois que, de nos jours, les relations des artistes et de tous ceux qui circulent dans leur orbite sont tirées au
clair, pour des questions de simple rhétorique, au niveau politique, social et économique. Je ne crois donc pas
qu'il existe aujourd'hui un art qui soit orienté pour exprimer les valeurs de ce qui est beau. Les relations
publiques occupent un espace d'intervention de plus en plus grand dans les mécanismes où elles s'organisent, et
les structures d'intérêts commerciaux sont en action pour essayer de soutirer le plus possible d'argent. Nous
vivons plongés dans une mise en scène de vie élégante où tout est fugace et difficile à saisir. Nous bâtissons des
rapports superficiels qui nous permettent de ne pas trop risquer le contenu de nos âmes, soit parce qu'il est
inexistant et il serait très difficile de le transmettre, soit parce que ce n'est même pas utile de le faire. Nous vivons
en suivant un régime d'engagement minimum selon lequel ce qui relève de l'ordre public ou de l'ordre privé n'a
pratiquement plus aucune importance. Nous ne sommes plus qu'une image.
Nous savons bien qu'il existe beaucoup de musiques urbaines. Elles sont une des conséquences d'un drame
existentiel engendré par les grandes villes à partir du XIXème siècle. Dans la préface du Spleen de Paris ,
Baudelaire proclame que la vie moderne exige un nouveau langage : « une prose poétique, musicale tout en étant
sans rythme, assez flexible et assez rude pour pouvoir s'adapter aux élans lyriques de l'âme, aux modulations des
rêves, aux sauts et aux sursauts de la conscience » (3). Ce qui nous frappe c'est que Baudelaire composa ces
poèmes en1860 et qu'ils contiennent déjà tous les présupposés essentiels de l'art du siècle suivant. On pourrait
déduire que la musique sans rythme, suffisamment flexible et suffisamment rude, a été transformée en concept
pour la première fois en une époque et dans un lieu qui n'étaient pas les siens et qu'elle a été comprise et
expliquée avec une extraordinaire clarté. Malgré cela, nous ressentons toujours l'art et la musique d'après une
manière de voir conservatrice, contre la révolution artistique et contre la rénovation permanente des moyens et
des formes. Et il faut dire que cette manière de voir est sauvagement imposée par ceux qui dominent les marchés,
et que tout est soumis à une compétition implacable, à l'intérieur de laquelle ne pas agir c'est tout simplement
disparaître. Innover pour pouvoir sauvegarder son affaire, tout contrôler pour garder sa place, oublier sa propre
liberté, obéir à la majorité, accepter la pression de la collectivité - tous ces éléments convergent et provoquent une
désintégration qui agit comme une force mobilisatrice et, donc, unificatrice. Nous aspirons tous à la stabilité,
mais cet état-là est synonyme d'entropie, de mort lente. Peut-être que l'on pourra maintenant comprendre à quel
point il devient essentiel pour la survie artistique qu'il y ait un processus de mutation constante dans toute
stratégie de conception de projets.
Nous appartenons au groupe immense des banalisés et, après tout ce que je viens de dire, il m'est difficile de
penser à ce qui va m'arriver ensuite, bien que les signes que je peux apercevoir, envoyés par ceux qui
m'entourent, m'inquiètent assez. Mais je ne suis pas inquiet au sujet de mon avenir, cette sorte de contrat entre
moi et le Diable. Des millions de personnes sont, chaque année, victimes de plans de développement désastreux,
victimes de l'incurie de tant de gens et tout le monde a l'air de très bien accepter tout cela. Ce que l'on pourrait
faire à ce niveau-là me paraît être très restreint.
En art, en musique, comme dans la vie, toutes les classifications sont abusives. Les lâches sont toujours en train
de bâtir des stratagèmes.
J'avais déjà réfléchi sur quelques uns des moyens d'action utilisés par les critiques, par ceux qui font les
promotions, dans le monde de la musique ou ailleurs. Ils révèlent toujours une croyance évidente dans l'histoire,
comme étant le seul moyen efficace de rendre leur activité éternelle ; ils regardent en arrière et ils croient à ce
qu'ils voient, ils sentent que cette réalité-là appartient intrinsèquement à leur vécu. Ils ne se sentent pas perdus,
même s'ils sont obligés de vivre parmi les innombrables difficultés d'un milieu où le mouvement et les sursauts
sont l'attribut permanent d'un quotidien en mutation perpétuelle. Ils éprouvent plutôt un immense plaisir, celui
de quelqu'un qui est partie prenante et qui, surtout, se construit en s'appuyant sur la certitude d'être un « acteur
» et de changer le cours des choses par son action. Pourtant, nous ne sommes partie prenante nulle part, nous
passons notre temps à gérer des incapacités de compréhension, dans cette course impétueuse qui nous tourmente
; entraînés, sans que nous puissions rien contrôler, dans le courrant des événements de chaque jour, où tout se
dilue, se métamorphose et se désintègre, jusqu'à ce que rien ne soit reconnaissable. La production et la
consommation sont telles que les activités humaines deviennent de plus en plus cosmopolites. Les rapports de
proximité ont succombé et sont disparus ; ils ont laissé la place à des communications à une échelle planétaire,
d'un niveau technologique élevé et d'une sophistication raffinée. L'automatisation s'est développée à un rythme
vertigineux, voulant désespérément saisir chaque instant. Eliminer l'espace temps entre l'événement et la
réception de l'information le concernant est sans doute un des buts de ce drame intensément bourgeois et
capitaliste où nous sommes plongés. Les idées devraient être un moyen de créer d'autres nouvelles idées, c'est
pour cela que l'on croit que toutes celles qui nous surgissent d'une manière définitive n'ont aucun intérêt. Quand
quelqu'un saisit l'occasion de parler d'un concert pour dire ce qu'il en a pensé et le fait à l'intérieur d'un modèle
fermé, absolu et achevé, il laisse automatiquement de côté la chance qui lui était donnée de développer une idée
créatrice. Nous vivons en permanence entourés d'idées mortes et qui ne contiennent aucune incitation à créer du
nouveau. Il s'agit de récits au bord de l'exhaustion, dépourvus de vie intérieure, prisonniers d'une bergerie de
choses prévisibles où le plaisir de la découverte s'est figé. Au Portugal, la rhétorique du jazz présent tous ces tics,
ankylosés dans une répétition compulsive. On trouve également dans certains textes un mépris catégorique,
presque hystérique, de ceux qui font la musique. Alors que, dans d'autres, on voit poindre les excès d'une foule
idolâtre, aveuglée par son avidité mythologique. Tous les régimes totalitaires essaient de pousser à l'extrême la
collectivisation des idéologies qui ont servi de base à leur structuration. Le jazz subit souvent ce type de tensions,
où le musicien/ mythe, étant le résultat d'un échafaudage de l'esprit d'une collectivité frustrée, apparaît a priori
comme un être supérieur, même avant d'avoir joué quoi que ce soit. Il m'est impossible d'approuver ce genre
d'impulsions, même si je les comprends, même si je vois leur utilité dans une société qui n'a plus aucun dieu dans
lequel elle pourrait croire. Car il y a de nos jours une puérilité de circonstance qui pousse les gens à rechercher
des mythologies alternatives dans le monde de l'art. Le jazz qui est annoncé par les magazines, par les journaux,
par les medias est une musique fantomatique plongée dans des formes et des symboles morts depuis longtemps.
Et les gens s'obstinent, les gens perdent leur temps à écouter ces choses-là et à en parler, car ils sont l'incarnation
de la modernité du sous-développement. On pourra toujours écrire sur le jazz, on pourra toujours en parler, mais
personne ne pourra contrôler les actions ni les interactions qui se développent dans son sein. L'art sera toujours
une sorte d'espace de liberté où toutes les forces psychologiques et sociales s'épanouiront spontanément. Si ce
que nous disons ou écrivons a la lourdeur d'une idée close (comme je lai déjà souligné plus haut), il ne nous
restera que le ridicule sentiment de quelque chose de raté et de fragile. Au Portugal, on a l'impression que tout est
raté.
J'ai le sentiment que si je ne parlais que du jazz, je me satisferais d'une certaine pauvreté, alors qu'on peut
étendre notre vision à de larges domaines artistiques. Je n'émets aucune réserve en ce qui concerne le jazz, mais
je m'aperçois que le fait de regarder les choses à travers lui est très réducteur. C'est pour cette raison qu'une
bonne partie de ce que je m'apprête à dire devra être placé dans une perspective plus large. Les phénomènes
existentiels peuvent être indifféremment appliqués à tous les champs de l'activité artistique ; donc, les points de
vue qui ne concernent qu'un certain type de musique, les points de vue qui ne concernent qu'un œuvre d'art
précis, s'ils ne sont pas insérés dans une démarche de compréhension plus globale, ne seront jamais qu'une
chronique de plus, sans conséquence ni intérêt. Nous vivons dans un monde d'apparitions éblouissantes, de
brillantes façades, de spectacles triomphants, de décorations, de styles, de brillances et ainsi de suite. Les visages
sont creux, nous trouvons des ébauches de beautiful people partout, et partout une harmonie jaillissante est
préservée au milieu du tumulte de tous ces gens ordinaires en mouvement. On a voulu que tout soit ainsi
structuré dans les capitales du monde civilisé, dans un équilibre d'habiles efforts et de vie dégradante. L'art
ressemble de plus en plus à des affiches publicitaires où la voyante élégance intellectuelle convertit ce' qui est
mondain en quelque chose de provincial. Nous sommes tous devenus du matériel publicitaire, sans que personne
ne nous paie pour cela. C'est ça notre culture. Où est-elle, cette aventure spirituelle moderne que les spécialistes
claironnent sans arrêt à nos oreilles ? C'est qu'en ce moment ils sont trop occupés à bâtir les stratégies de
promotion de leurs propres carrières. Ils recherchent la réussite de leur affaire comme n'importe quel capitaliste.
Ils sont devenus lourds, solennels, je me demande s'ils arborent des moustaches, ils n'ont plus de regard, plus de
détermination, et pourtant leurs visages rayonnent d'une fierté joyeuse et obéissante. Ils sont ainsi faits, nos
artistes et leurs acolytes. De nos jours, la culture est devenue une activité de plus en plus douteuse et elle cherche
à attirer les esprits les plus libres dans son défilé de vanités. Un défilé qui est le reflet de la rapidité des expédients
utilisés, de l'agilité jongleuse des opportunistes, des gracieusetés hypocrites des jugements de valeur, de l'absence
de pitié pour autrui, de cette espèce d'éclat visqueux dans le regard des concurrents, et qui revêt une couleur
assez kitch pour rehausser tout le reste. Toutes les victimes ont en commun un certain nombre de caractéristiques
de base qui leur permettent d'exercer pleinement leurs fonctions dans les destins qui leur sont réservés. Il ne peut
pas y avoir de victime qui n'ait pas un destin propre, sans une prophétie, sans quelque chose qui annonce son état
final de bouc émissaire rituel. La victime est toujours honnête et consciencieuse, elle est timide et modeste, elle
s'écarte des intrigues qui nourrissent et intéressent ses compagnons de vie. Je le sais depuis longtemps, les
intrigues et les moqueries rendent plus agréables les journées de bien des gens. Mais, dans ce domaine, la victime
joue un rôle essentiel. Elle ramasse à l'intérieur d'elle-même toutes ces énergies et il y a chez elle une
extraordinaire prédisposition naturelle pour se charger du poids du ridicule des autres. Dans ce sens, elle joue un
rôle qui préserve l'hygiène sociale parce qu'elle dissout les conflits et endosse toutes les responsabilités dont les
autres veulent se décharger. Les gens aspirent à des choses très simples ; ils veulent, par exemple, pouvoir
communiquer librement et pouvoir se reconnaître comme étant égaux. Mais les victimes les gênent, car elles les
empêchent de réaliser leurs aspirations, car leurs yeux les questionnent et exigent des réponses au sujet des
objectifs de leur bavardage incessant. Les medias n'unissent pas les gens, ils creusent plutôt un énorme abîme
entre eux et ils abolissent de plus en plus les faibles rapports qui les unissent encore. Et les victimes se mettent à
trop ressembler à ceux qui ne le sont pas. Il y a maintenant une ineffable ambiguïté entre tous ceux qui sont
devenus les moules qui servent à fabriquer des énigmes. Ils ont tous le regard du sphinx.
Je comprends parfaitement que tout le monde croit que la sympathie pour les faibles et les opprimés va de pair
avec un certain maniérisme intellectuel et raciste que le colonialisme portugais devait transformer en idées de
politique sociale. Cependant, de la théorie à la pratique la distance est grande. Au Portugal, quand il s'agissait de
jazz, à l'époque où se déroulait la guerre coloniale, j'ai toujours considéré cette espèce de déférence vis-à-vis des
noirs américains comme un obscurcissement pervers, une sorte de plaisir provoqué par leurs souffrances. La
fascination causée par l'état dégradant des noirs avait rendu plus évidente cette étrange réaction hyper
colonialiste . Il serait impossible de trouver, dans aucun autre pays, des gens, comme les portugais, qui étaient
capables de prendre comme idéal une société où les noirs étaient chargés de fournir le spectacle pour que les
blancs en jouissent. J'ai toujours aimé les classements d'idées et quand, aujourd'hui, je revois un certain nombre
de réactions de personnes qui écrivent sur le jazz et qui sont encore sous l'influence de cet esprit colonial
éminemment raciste, je suis perplexe et je me demande si elles se rendent compte de ce que cela veut dire.
Actuellement, la couleur de la peau ne peut être revendiquée que par celui qui prétend démontrer que cette
couleur peut être utilisée comme un argument dans le domaine de l'art ou de la musique. Celui qui le fait ignore
les présupposés essentiels de la société moderne. Pour certaines personnes la minorité ethnique reste un
mécanisme compréhensible d'une réalité donnée. Et le concept qui engendra, par exemple, l'idée du
blanchissement du jazz, est encore une forme embryonnaire de leur classement géographique de l'homme selon
son continent d'origine. C'est une sorte de taylorisme darwinien que rien n'a jamais réussi à éliminer de notre
conscient collectif. Rien n'y fit, même pas les délices libératrices de la démocratique Révolution de Œillets. Les
persécutions politiques, religieuses et sociales sont devenues des maux endémiques qui réapparaissent
constamment avec des développements divers, selon les différentes intériorisations du temps et de l'espace où
elles se subliment et se répercutent.
« Des triomphes des expressionnistes abstraits aux initiatives radicales de Davis, Mingus et Monk, dans le jazz,
et jusqu'à des œuvres littéraires comme La Chute de Camus, En attendant Godot , de Becket, The Magic Barrel ,
de Malamud, et Le Moi Divisé , de Laing, les travaux les plus intéressants de cette époque se caractérisent par
une distance radicale par rapport à tout milieu partagé ».(4) Il faut préciser que le mot milieu désigne le milieu
urbain de la grande ville - dont la première construction résolument moderniste surgit à la fin du XIXè siècle et a
été un élément déterminant de tout le XXè; la construction allait être un besoin urgent dans un monde en
rénovation constante. Nous vivons encore aujourd'hui au milieu de cette mobilisation générale et entreprenante
d'une société qui résiste en créant des progrès successifs. La ville est devenue un lieu en construction, une scène
pour des spectacles nouveaux, où les lumières, les machines, les ouvriers et les matériaux assurent un spectacle
qui maintient le public sous le charme. Tout le monde fait des projets pour de nouveaux espaces, tout le monde
restaure les coins dégradés. On crée des parcs, des avenues, des édifices, des viaducs, des ponts, des autoroutes,
des quartiers, des usines, des bureaux, des musées, des bibliothèques, des stades, des métros, des centres
culturels, des trains à haute vitesse, des aéroports, des fronts de mer aménagés. Et nous cherchons toujours une
issue pour ce développement qui s'auto- dégrade, comme un serpent qui se mange la queue au milieu du flux
incessant des lois de la circulation. Un mouvement insatiable. Et l'art agonise, perdue dans ces sommets de
créativité exubérante, implacable et déplorable. Chacun doit avoir son heure de gloire publique et, donc, rien
n'est jamais résolu. Ce moment de gloire pousse toujours les hommes à vouloir faire plus que les autres. Pendant
ce temps surgit l'idée du recyclage qui élargit les possibilités de découverte de nouveaux sens pour un monde, lui-
même appauvri à l'extrême, dégradé, ruiné. L'artiste va essayer de vaincre, une fois de plus, les difficultés
habituelles qu'il a pour s'affirmer dans un milieu de plus en plus aliéné, et il va essayer d'occuper ce nouveau
créneau, fait pour perpétuer le développement de l'univers bourgeois. Le mot démolir deviendra le mot-clé du
désordre, d'une entreprise qui accaparera son dévouement pendant une bonne partie des années de son existence
obsolète. Nous vivons dans une époque de démolitions plus ou moins bien organisées. Nous sommes déjà arrivés
à une période où nous pouvons tranquillement savourer l'idée de pouvoir tout démolir. C'est une démolition
planétaire. Aujourd'hui, nous avons découvert l'image qui représente parfaitement nos villes : c'est un
échafaudage permanent de symboles que l'on colle et qui s'abîment, c'est un mur de panneaux publicitaires.
Partout, surgissent des murs d'affiches couverts de choses inconséquentes, baignant dans une idéologie
universelle décadente, terrorisée par des conflits incurables et menaçants. La tension suburbaine n'a jamais été
aussi présente que de nos jours dans nos vies, ni d'une manière si globale. Les spectateurs de l'art- spectacle sont
les membres de cette communauté en faillite et les musées poussent les gens à s'asseoir pour mieux regarder la
radicalité post- moderne. Nous sommes enfermés sous un manteau impalpable de bronze, sous un firmament
minéral qui plane au-dessus de nos têtes, dans un monde sombre où les lignes de notre vie se rencontrent comme
sur un tableau, pour engendrer une nouvelle intégration de l'espèce humaine.
Les expositions institutionnalisées et les concerts donnés dans de grands amphithéâtres sont des parodies de
l'organisation de la culture assenées par les artistes. Parfois l'artiste et ses auditeurs se confondent. Et je ne vois
pas qui pourrais-je accuser : peut-être les circonstances qui ont fait la promotion de cette utilisation non
discriminée des gravats dans la construction des nouvelles formes d'art ? peut- être la période où la participation
active et populaire transforma fit de l'art un investissement ? Aussi bien l'état que les mécènes, tout le monde veut
créer une sorte de beauté cosmétique et une couche protectrice qui masque pieusement toute la brutalité et toute
l'avidité de la glorieuse entreprise. Les musées sont très vite passés maîtres dans l'art de bien construire une belle
façade pour cacher toute cette entreprenante pourriture. Et les artistes habitent dorénavant, et chaque jour
davantage, au pays où règne un esprit de frontière. Là, Les hiérarchies se ramollissent, puisque tout le territoire
est en mouvement. On y voyage sous des profondeurs ensevelies, dirigé par de majestueuses visions de ruines,
dans des salles où règne la dégradation et la mort, avec des échappées que l'on aperçoit en traversant des édifices
en verre, et c'est cela notre voie rapide vers la suprême beauté au milieu des cohortes de la misère humaine - et,
toujours, il y a de l'encre qui dégouline dans un coin.
J'en ai marre de l'histoire. Je passe à côté de corps abandonnés, abîmés, vidés pas l'avarice insensée de certains,
des corps passionnés qui bougent à l'intérieur de capsules ouvertes dans les profondeurs d'énigmatiques films
muets. Je traverse des réseaux de communication, de splendides monuments, des vitalités et des angoisses, des
bruits, des matériaux sonores et des rythmes, des musiques qui font vibrer les tympans de mes oreilles. Et,
pendant ce temps-là, les gens s'achètent des voitures et de nouveaux fards pour leur visage. La vie à l'envers qui
me croise à toute vitesse me crie au passage qu'elle court à la poursuite de l'aventure et, moi, je me sens alors en
sûreté. Je suis parfaitement capable de me rendre compte du moment où les ruines se sont suffisamment
accumulées pour que puisse se déclencher une nouvelle variante destructrice : et on sera arrivé à un nouveau
sommet, et on atteindra l'apogée de cet espace- catastrophe où l'on fait de l'art avec des restes.
Dans les musées, même la poussière contient de la culture ; il y a de l'imagination même dans leurs déchets ; on
peut se souvenir, on peut essayer d'oublier, comme dans un combat intérieur.
Il faut que nous sachions traduire la réalité à partir d'un manuel- mode d'emploi ; Que nous essayions de
comprendre qu'il y a un certain nombre de questions intéressantes qui se posent quand on veut utiliser une
langue différente, même quand il s'agit de textes tout à fait ordinaires sur des mécaniques, ou concernant le
tourisme, l'art ou encore la littérature. Tout cela devient un produit inachevé qui ouvre des voies vers
l'intervention créative.
J'écris dans des conditions difficiles. En prenant la plume, je me sentais comme un marginal vis-à-vis des intérêts
de groupe qui entraînent les échanges de services rendus et d'ennuis personnels ; mais ce n'est pas forcément un
inconvénient. C'est pour ça que j'éprouve le besoin d'aller très vite, car j'ai peur de laisser filer cette chance qui
m'est offerte par la période d'exclusion que je traverse. L'approbation des autres, les aides, la reconnaissance ne
produisent que des personnages médiocres, débordants de conformisme. Nous sommes des êtres en mutation,
nos qualités dégénèrent, et nous survivons au sein d'une organisation secondaire de pillages perpétuels en nous
appuyant sur une demi douzaine de dogmes menaçants.
Nous sommes soumis en permanence à une succession de rencontres de plus en plus anonymes, expérimentales et
fugaces. Les personnes ont perdu leur visage, leur corps et leur histoire, elles ne sont que ce qu'elles laissent
transparaître. Et c'est dans ce contexte que se développent les nouvelles formules des rapports humains et de
l'organisation de la vie quotidienne, qu'il est urgent de repenser. Nous sommes maintenant confrontés avec de
nouvelles conceptions de l'espace et du temps. Je me demande si la vieille question du temps réel aura un
minimum d'intérêt pour les nouvelles perspectives d'interaction qui nous arrivent. Le concept de virtuel, qui nous
vient de l'internet, sera étendu à d'autres dimensions qui s'appliquent à des mondes et à des visions
extrasensorielles, qui d'ailleurs étaient, si l'on peut dire, déjà annoncées depuis toujours par l'usage des drogues,
de l'alcool et des produits chimiques. On voulait déjà, par l'utilisation de ces produits, aller au-delà des sens,
d'abord, et ensuite, au-delà de l'esprit, pour aller vers ces autres dimensions extrasensorielles. Les gens se sentent
tout à fait innocents grâce à l'apparition d'un mécanisme qui les rend peu à peu irresponsables, à un tel point
que, s'il nous fallait les prendre vraiment au sérieux, il nous faudrait créer un nouveau langage. Tous ceux qui
veulent entrer dans ce nouveau jeu devront pouvoir avancer tout en restant invulnérables aux moqueries et aux
médisances, tout en restant indifférents s'ils sont maltraités, et ne devront surtout pas réfléchir sur eux-mêmes.
J'ai horreur des définitions. Nous apprenons tous à les utiliser dès notre enfance et cela amoindrit les futures
chances que nous aurions d'avoir des intuitions révélatrices. Nous devenons des copies d'autres copies. Pour
certains la culture a toujours été un « processus de développement et d'anoblissement des facultés de l'homme ».
Mais cette définition va finir par être démodée. Je préfère celle qui l'associe à des modes de « pensée et de
comportement qui sont transmis par interaction communicative ». Ou alors celle qui dit que « l'homme est un
animal suspendu à des toiles de signification tissées par lui-même », et que « donc, ses analyses ne constituent
pas une science expérimentale à la recherche de lois, mais plutôt une science interprétative à la recherche de sens
». (5) Je ne veux pas, car je serais incapable de le faire, donner des explications au sujet de ce besoin de définir les
choses. Il est évident que cette pratique est enracinée dans nos habitudes ancestrales, qu'elle joue un rôle
important dans ce mécanisme qui accumule et qui transmet des informations à l'intérieur d'un monde très limité
en ce qui concerne les moyens de communication. Mais, de nos jours, alors que nous connaissons l'énorme
quantité de ressources disponibles, il faudrait forcément changer les choses. Ce qui me séduit le plus dans une
structure sociale, ce sont ceux qui, tout en agissant dans son sein, ne se montrent pas favorables à son
développement. En quelque sorte, toutes les constructions engendrent automatiquement des forces contraires
qui cherchent à la détruire. Cette tension provoquée par des points d'orientation différents, on peut l'appeler «
culture ». Il existe un effet de collage qui fait que, comme le dit Giddens, « la présentation des media revêt la
forme d'une juxtaposition d'histoires et d'éléments qui n'ont rien en commun, sauf le fait qu'ils sont opportuns et
séquentiels ». La vie apparaît comme une réalité, unie en apparence, alors qu'en fait elle est une superposition
d'éléments variés qui radicalisent, globalisent, reproduisent, combinent encore et créent de nouveaux contenus.
Tout acte exige une participation dont le processus entraîne une hiérarchisation où agissent des pouvoirs
politiques, économiques et sociaux. Il y a donc une stratification de plans où des individus et des organisations se
rencontrent.
Ce qui m'étonne le plus chez les gens - car rien de ce que j'ai dit jusqu'ici ne pourrait être un objet d'analyse sans
eux - ,c'est la cohérence, la patience et la sérénité. L'ironie et le sens de l'humour viennent parfaire le nombre des
caractéristiques que je considère indispensables pour que l'on puisse vivre d'une manière inaperçue au milieu
d'événements multiples. Le plus difficile est d'en faire une analyse cohérente. La simplification de cette tâche ne
devient possible que quand tout ce que l'on éprouve est la conséquence d'une façon d'exister infatigable. Qui est-
ce qui enseigne à travers la pratique ? Bien peu de monde.
S'il nous faut dénoncer ce qui se passe c'est parce que nous sommes souvent tentés de taire ce qui peut provoquer
une opposition chez les gens et qui donc doit être omis. Nos dialogues ressemblent de plus en plus à des réponses
à des lettres. Il sont écrits par un quelconque ordinateur.
Il est révolu, le temps où l'art jouait un rôle fondamental dans la mise en perspective des idées les plus radicales.
De nos jours, seuls les discours politiques et religieux parcourent inépuisablement le chemin qui devrait mener à
une société quelque peu viable. Le flux ininterrompu d'actions constructives et destructrices dessine l'apparence
d'un terrain que l'on change et que l'on refait sous les auspices de nombreuses organisations correctrices.
Développées d'après une logique de systématisation perfectionniste et, très souvent, contraintes par des crises
saisonnières de développement, ces mesures d'épurement fonctionnel contribuent, quand elles sont mises en
route, à nous inculquer la certitude du fait que nous ne pourrons pas aller bien loin avec nos rêveries
régénératrices. Nous sommes à la recherche d'un paradis où chacun pourrait vivre selon ses aptitudes naturelles
et ses besoins personnels. Viennent ensuite ceux qui pensent leurs vies comme s'il était possible d'établir un
compromis entre l'émotion et la raison. Disons que le moi intellectuel - mot indéfini en soi et au sens peu clair -
essaie de s'orienter d'une manière apaisante au milieu des impulsions intérieures de nos vies spirituelles. J'aime
bien ces simplifications, ces visions dualistes qui se divisent, comme le moi divisé de l'antipsychiatrie. Ainsi, nous
rencontrons des personnes qui s'orientent dans ce terrain en utilisant des façons de penser incroyablement
puériles et qui n'ont aucune honte d'écrire et de publier leurs idées. Leur sens critique est tout simplement
transféré vers les autres, ceux qui sont l'objet de leurs visions ; et c'est comme ça qu'ils se tiennent quittes d'eux-
mêmes. Nous tombons toujours sur les mêmes tendances, les temps changent, mais les agissements se multiplient
toujours de la même façon. Où est la faille ? Nous vivons sur une terre dévastée par les excès.
Personne ne sait jamais ce qui arrivera par la suite, mais ils parlent tous comme s'ils le savaient. C'est le désespoir
provoqué par cette croyance dans un avenir prévisible qui me fait voir l'immensité de la dépense d'énergie causée
par tant de révolutions qui ont échoué. Cette foi imprévoyante qui nous entoure et laisse présager d'autres
lendemains qui chantent encore perdus ! Nous sommes un mirage, nous sommes les habitants d'une ville
fantôme, dont la grandeur et la magnificence se dissolvent dans l'air pourri par les cadavres et les projets qui ont
fait faillite. Nous sommes toujours en train de bâtir des châteaux, des monuments qui sont la manifestation d'un
symbolisme spectral qui se veut la représentation d'un dynamisme et d'une détermination salvatrice. C'est ce que
nous faisons quand nous construisons nos sépultures en les décorant comme s'il s'agissait de nos maisons. Les
cimetières représentent sans doute un des aspects les plus authentiques de l'activité quotidienne, car tout y est
consacré à cette fin - la nôtre. Nous gardons et nous maintenons une esthétique de sous-développement parce que
les artistes, avec leurs formes et leurs symboles créatifs, se sont vendus à une politique de travaux forcés et ils
travaillent comme des ouvriers à la solde d'un autre. Les musées et les organisations para- culturelles sont les
premiers enrôleurs de ce réseau de travail esclavagiste, qui s'est laissé enfermer dans un servage de leur art
soumis au pouvoir. Nous avons créé un système sans moteur, endormi, un poids mort qui confond l'art avec un
trafic de marchandises. Mais nous savons pourtant qu'il est important de pouvoir vivre dans un espace où la
volatilité et l'instabilité d'une culture pourraient se manifester naturellement, de manière à pouvoir engendrer
une polarisation durable des horizons de l'imagination, et en écartant les mesquins systèmes de reconnaissance
de leurs protecteurs. Il faut que l'artiste puisse exprimer une résistance permanente à ce que l'on tient comme
correct et qu'il la manifeste selon des modèles radicalement différents ; il faut qu'il se moque des cultes
superficiels imposants qui ne servent qu'à cacher la pourriture qui est derrière ; il faut qu'il se moque des «
manteaux de civilisation ».
Il faut dire qu'ils cultivent tous une sorte de rituel d'inimitiés brutales, ainsi qu'un mépris catégorique, je dirais
même hystérique, pour tous les autres. Ils recréent un climat sordide, narcissique, dans lequel tout le monde doit
se précipiter pour venir admirer leur image si ordinaire ; ils montent une représentation de la réalité qui peut se
définir par leur mépris dépourvu d'esprit critique vis-à-vis des personnes réelles qui sont autour d'eux. Nous
vivons à l'intérieur d'un deuxième spectacle de la vie élégante, comme s'il y avait un point vraiment crucial de
tout ce nouvel héroïsme.
Nous savions déjà que nous étions perdus, même si en ce qui concerne une bonne partie des tâches quotidiennes
les gens font toujours apparemment ce qu'ils peuvent. Parfois ils laissent tomber leurs masques et montrent leurs
visages torturés. Nous avons tous appris à ne pas trop souffrir pendant ces courts instants où apparaît leur
nudité. Car on vit au milieu de la fête de toutes les inimitiés brutales, qui se manifestent par une vulgarité
éphémère, changeante et frivole. La pourriture attire la pourriture.
Il y a des moments où je m'enfonce dans la tristesse. Tout un choix d'innombrables sentiments inachevés me
traversent en courant. Fugaces comme un regard. Et pendant ce temps-là on continue à perdre du temps avec des
mots. Les gestes sont dépourvus de but pratique. Ils m'apparaissent comme des dandinements rustiques
transformés en plein de raisons immergées. Un milieu humide a envahi le lieu où j'essaie de me contrôler. Mon
enfance surgit avec une netteté inquiète, qui se confond avec le moment présent et réel. Je me sens vidé et je
dépéris à l'intérieur de moi-même.
Nous le savons tous : défendre les chances de la création, au sein d'une société monolithique, où l'uniformisation
des offres, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, provoque une simplification et une indifférenciation
générales, est une tâche de la plus haute importance pour les temps à venir. La diversification des produits
n'accompagne nullement la variété des goûts. La concurrence, suivant une logique libertaire qui essaie d'obtenir
un maximum de gains, tout en respectant des délais et avec des dépenses minimales, régresse constamment, alors
que la concentration au sein de l'appareil productif et de diffusion progresse. Une puissante censure, imposée par
l'argent de ceux qui investissent, est en place. Les favoritismes éhontés d'un groupe détenteur de pouvoir
entraînent des abus de pouvoir qui proviennent d'une domination exercée sur les circuits de divulgation. Le gain
n'a jamais été, comme aujourd'hui, associé à une esthétique à courte vue et à un esprit d'entreprise dominant et
frauduleusement déloyal vis-à-vis de toute action indépendante. Cette nouvelle pratique monopoliste occupe une
place de plus en plus prépondérante dans l'univers des productions culturelles. Notre système éprouve le besoin
de monter une structure qui justifie le succès artistique et commercial par l'irruption de nouvelles stars
médiatiques. L'artiste et les affaires nous apparaissent alors liés par des rapports de rentabilité maximale, dans
laquelle le créateur se loue lui-même au sein d'un tout commercial, suivant une logique qui est la négation la plus
complète de la culture. Quand on arrive à ce point de destruction totale des valeurs et des principes, que l'on
brade pour avoir des compensations incertaines et dérisoires, nous nous apercevons que tout cela fait partie d'un
immense discours néo-libéral inculqué par des procédés d'endoctrinement collectif des consciences de ce qu'on
appelle le grand public. La culture se nourrit chaque jour davantage de la souffrance de quelques victimes
anonymes qui succombent jour après jour d'une mort méconnue et qui contribuent avec leur sacrifice existentiel
à sa superbe institutionnalisation. Gombrich disait que quand « les conditions de vie écologiques » de l'art sont
détruites, l'art lui-même n'a plus beaucoup de temps à vivre. Tout sera toujours sérieusement menacé, tant que
nous vivrons dans cette atmosphère de collapsus imminent. L'anxiété créée par cet état de choses favorise
l'avènement d'étranges mécanismes de destruction. On dirait que nous nous sentons dispensés de suivre les règles
minimales de la vie commune, d'une vie commune pacifique. Nous nous regardons alors les uns les autres d'une
manière maladive, imprégnés que nous sommes d'une logique de peur individualiste qui nous pousse à des
pratiques égocentriques de survie à tout prix. Tout le monde vit sous la menace du système commercial, tout le
monde est dominé par ceux qui détiennent le pouvoir ou par leurs agents serviles, dominé par les critiques qui
sont au service du système, par les artistes qui se sont vendus en time-sharing à de différentes organisations
commerciales qui les ont appâtés avec le succès et le bien-être. L'art est en train de devenir une marchandise ; et
l'affluence des gens qui vont voir une exposition, un concert, un film, le chiffre des ventes, les critiques publiées et
leur incidence médiatique, prennent la forme d'une sorte de plébiscite du grand public, qui revêt l'apparence
d'une appréciation démocratique au goût de tous.
Quand je m'exprime sur ces sujets je sais bien que mon attitude sera taxée d'exagérée. Je serai un personnage de
plus parmi ceux que l'on range dans le musée des prophètes de malheur. Je me place dans une situation
extrêmement difficile et j'aurai du mal à mettre sur pied une analyse efficace de notre actuelle époque si pleine
d'énormes contradictions et de pénibles dégradations.
Au milieu de cette catastrophe ambiante on cultive un air de modernité progressiste, alors que tout apparaît
comme dangereusement rétrograde et durement conservateur. Nous sommes entourés d'une rhétorique
insidieuse, envahissante et banale, qui se construit à partir de l'utilisation abusive de formules de guérisseur
contre les maux sociaux, et dont la puissance incantatoire continue de recruter des adorateurs, des marchands,
des employés, des escrocs, des corrompus, des hommes politiques, des clercs de la culture, et tant d'autres
endoctrineurs, tant d'autres endoctrinés ! L'avalanche destructrice du mensonge, plus ou moins clairement
exprimé, part du sommet d'une hiérarchie où trône celui qu'on appelle «l'intellectuel médiatique». Cet état de
choses d'ordre culturel est orchestré de nos jours avec un cynisme parfait, que l'on aperçoit en regardant le vrai
visage de toute l'histoire de la culture occidentale, cette culture qui est maintenant à genoux devant l'attrait du
gain et qui couvre parfaitement la violence sous-jacente. Nous sommes face à un nouveau système de contrôle sur
tout ce qui est du domaine de la pensée et de la libre expression.
Quand nous défendons notre singularité, nous défendons également les valeurs les plus universelles.
(1) Marshall Berman, Tudo o que é Sólido se Dissolve no Ar, Edições 70, Lisboa 1989, p. 154;
(2) Ibid, p. 145;
(3) Ibid, p. 162;
(4) Ibid, p. 333;
(5) James Slevin, Internet e Sociedade, Temas & Deabates, Lisboa, 2002, p. 107.
TRADUCTION: ANA CORTE-REAL